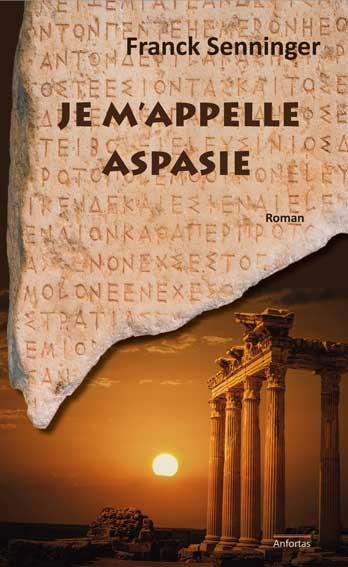Le retour chez soi et les portes du bonheur
Le retour
Ulysse, revenu sur son île, rencontre Athéna. Elle accentue les rides de son protégé et lui donne l’apparence d’un vieux mendiant, de façon à le rendre méconnaissable. Elle lui apprend que cent douze princes courtisent sa femme afin de l’épouser et de régner sur Ithaque. Ils boivent son vin, occupent son palais et couchent avec ses servantes. Pénélope, elle, tisse depuis trois années un linceul pour Laërte, son vieux beau-père lorsque celui-viendrait à rejoindre le royaume d’Hadès. La nuit la fidèle épouse se lève pour défaire ce qu’elle a accompli le jour.
C’est sous cette apparence qu’Ulysse se fait reconnaître de son fils Télémaque qu’il avait abandonné alors qu’il n’était encore qu’un très jeune enfant. Alors que le jeune homme doute, Athéna redonne pendant un moment son aspect véritable au héros de la guerre de Troie. Ulysse demande alors à son fils de garder le silence sur son identité vis-à-vis de tous, même de sa mère Pénélope.
Ulysse poursuit alors son chemin et arrive au seuil de son palais où son fidèle chien Argos l’attend depuis vingt ans. À sa vue, l’animal dévoré par les puces, incapable de se lever, pousse un jappement, dresse les oreilles et… expire, enfin en paix, heureux d’avoir revu son maître avant de succomber. Celui-ci essuie une larme, et ne peut exprimer plus avant sa douleur sous peine de se trahir.
Il entre alors dans la salle où festoient les prétendants à la main de Pénélope. Là, ces derniers se moquent de ce mendiant et vont même jusqu’à le rudoyer.
La reine, outrée de la manière dont on traite son hôte, le fait quérir et demande à sa servante Euryclée de lui laver les pieds comme le veut la coutume lorsqu’un étranger demande l’hospitalité.
C’est alors que l’ancienne nourrice d’Ulysse découvre sur sa cheville la cicatrice d’une très ancienne blessure, provoquée par un sanglier, alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune homme. Soudain, elle comprend qui est ce vieil homme, laisse échapper un cri et s’apprête à l’embrasser quand le roi lui intime de garder le silence. Par chance, Pénélope ne s’est aperçue de rien.
La vengeance
Le lendemain, Ulysse se fait reconnaître de Eumée, son porcher, et de Philéteos, le bouvier. Ils doivent subtiliser les armes du palais pour les apporter à Ulysse et à son fils Télémaque. L’heure de la vengeance a sonné. Au cours du banquet de cette journée fatale, les prétendants demandent à Pénélope si elle a enfin pris sa décision d’épouser l’un d’entre eux. Dans le but de repousser cette échéance, elle déclare qu’elle donnera sa main à celui qui arrivera à décocher une flèche avec l’arc d’Ulysse de telle manière que celle-ci passe à travers les anneaux de douze haches plantées en terre.
Pénélope est une princesse. Fille d’Icarios, roi de Spartes et de Polycaste. Elle est décrite comme la fidélité personnifiée.
Tous essaient l’un après l’autre de plier l’arc afin d’attacher seulement la corde à ses extrémités, sans y parvenir. Alors, Ulysse, toujours sous ses haillons, demande à essayer. Les prétendants s’esclaffent et le ridiculisent quand, soudain, ils s’aperçoivent que, sans grand effort, l’arc est monté avec sa corde. Ulysse la fait même tinter. Il place une flèche, vise les anneaux et tire. La flèche passe au milieu des anneaux sans dévier. Une exclamation de surprise s’échappe des poitrines quand Ulysse place une seconde flèche qui atteint cette fois la gorge d’Antinoos (sans esprit) le plus vindicatif des prétendants. C’est alors un carnage. Tous meurent sous les flèches, puis sous le glaive d’Ulysse secondé par son fils.
La reconnaissance
Même une fois son royaume reconquis, Pénélope refuse de reconnaître comme tel son époux. Elle lui demande de dormir ailleurs que dans sa chambre, mais s’il veut déplacer son lit, elle le fera porter où bon lui semble.
Ulysse s’écrit que la chose est impossible, car le lit est taillé dans le tronc d’un olivier. Or, seuls Pénélope et Ulysse connaissent ce détail. Ce n’est qu’à cet instant qu’elle reconnaît Ulysse.
Il ne manque plus à Ulysse qu’à rencontrer son père adoptif, Laërte. Il lui montre sa cicatrice et lui énumère tous les arbres fruitiers que ce dernier lui a offerts avant son départ pour Troie. Alors, Laërte, tombe dans ses bras et l’embrasse.
Et le bonheur dans tout cela ?
On peut se montrer surpris par cette démarche qui consiste à transformer dix années de combat où Ulysse a vu mourir tous ses compagnons et beaucoup de ses amis, dont le célébrissime Achille comme une quête du bonheur. Pis, son retour se transforme en une véritable guerre contre les éléments, contre la nature et contre sa nature. À de nombreuses reprises, comme dans l’épisode des sirènes, il doit se faire violence pour ne pas succomber. Et quand il rentre, il ne trouve pas la paix. Loin de là. Il doit encore non seulement combattre les prétendants, mais aussi se faire reconnaître. Alors, où est le bonheur dans tout cela ?
Peut-être est-il utile de définir ce qu’est le bonheur.
Selon le dictionnaire Littré, bonheur veut dire proprement bonne chance, et, par conséquent, il exprime l’ensemble des circonstances, des conditions favorables qui font que nous sommes bien. Il a donc un caractère extérieur, objectif, qui en fait la nuance avec félicité. La félicité n’est point liée à ces conditions du dehors ; elle est plus propre à l’âme même ; aussi, on ne dira pas : la félicité que les richesses procurent ; mais on dira : le bonheur qu’elles procurent. La béatitude, qui est du style mystique, est la félicité destinée, dans une autre vie, à ceux qui auront pratiqué la vertu dans celle-ci.
Certes, si l’on s’en tient à cette définition, on ne peut pas dire que le héros de Troie ait été particulièrement servi par la chance. Une fois toutes ses épreuves terminées, son état émotionnel serait plus proche de la félicité, encore que ce mot ne corresponde pas non plus à la situation. C’est tout le problème des mots par rapport aux mythes. Les mots enferment dans un concept alors que les mythes ouvrent l’imaginaire et parlent à l’âme, sinon du moins à l’esprit. Nous pouvons donc garder le terme de bonheur plus générique et qui correspond le plus à ce qu’Ulysse une fois victorieux de toutes ces épreuves, a sûrement ressenti.
Dès lors, une autre question se pose : Ulysse aurait-il trouvé le bonheur s’il n’avait pas subi toutes ces épreuves ?
Si Ulysse était rentré sans encombre dans son royaume d’Ithaque, aurait-il trouvé le bonheur ?
L’épisode de Calypso répond à cette question. Une vie sans encombre, sans but à atteindre, sans réussite personnelle, sans défi à relever. En un mot, une vie sans désir à satisfaire ne peut apporter le bonheur. Il est même notable que les encombres, les embûches, même insignifiantes, créent le bonheur une fois celles-ci résolues. Chacun de nous vit ce paradoxe chaque jour :
Lorsqu’on attend un coup de téléphone qui ne vient pas et que l’on désespère, quel bonheur d’entendre son téléphone sonner !
Lorsque l’ordinateur n’en fait qu’à sa tête, qu’il égare des fichiers importants, quel bonheur d’enfin retrouver ce que l’on croyait perdu !
Lorsque la voiture toute neuve semble rayée et que l’on se désespère, quel bonheur quand un coup de polish lui rend tout son éclat !
On pourrait multiplier les exemples. Chaque jour apporte son lot de contrariétés et de petits bonheurs. Mais existe-t-il vraiment des petits bonheurs ? La somme de ces petits bonheurs ne constitue-t-elle pas un grand bonheur en fin de compte ? Et si le message de l’Odyssée était celui-là. Si toutes ces épreuves qu’Ulysse traverse étaient volontairement disproportionnées, caricaturées.
Étant donné que, dans les mythes, il n’y a ni temps ni espace, on peut représenter ces dix années et ces douze étapes sous la forme d’un seul cadran de douze heures. À chaque heure, son embûche. À chaque heure son bonheur. À chaque heure sa bonne heure.
Bien sûr que tous les « problèmes » ne se résolvent pas, mais c’est ce qui fait toute la force du bonheur quand la solution se fait jour et que l’on en ressort « victorieux ».
Encore faut-il ne pas se fourvoyer…
Si l’on reprend ces douze étapes et sans leur donner un sens moralisateur, on reconnaît des circonstances courantes destinées à améliorer son bien-être qui mènent au mieux dans des impasses, au pire dans des situations encore pires que celle à laquelle on tentait d’échapper.
- Les Cicones : s’emparer du bien d’autrui.
- Les Lototphages : Rechercher des moyens artificiels pour accéder au bonheur
- Polyphème, le cyclope : Ne pas savoir montrer une certaine humilité.
- L’île d’Éole : Négliger ce que les autres pensent de vous ainsi que la jalousie.
- Les Lestrygons : Se rendre sur des terrains inconnus sans la moindre prudence.
- Circé : Hypothéquer son âme pour les plaisirs.
- Le royaume d’Hadès : On ne peut accéder au bonheur que si l’on connaît la valeur de la vie et donc le monde des Enfers.
- Les Sirènes : aborder certaines connaissances de trop près et éviter les profiteurs
- Les Roches Errantes : Un choix implique un sacrifice. Un mauvais choix peut entraîner un effet désastreux.
- Les bœufs sacrés d’Hélios : Le sacrilège.
- Calypso : Vouloir rester jeune à tout prix.
- Nausicaa : L’idéalisation.
Le bonheur est affaire personnelle et nul autre que soi ne peut le partager.
Il est à remarquer qu’Ulysse parvient seul à sa destination. Ses 1440 guerriers ont tous péri. Là encore, il faut appréhender ces disparitions sous leur forme symbolique. Ceux qui n’ont pas été initiés par la vie ou par une démarche personnelle ne peuvent accéder véritablement au Bonheur avec une majuscule.
On peut aussi envisager ce long périple ponctué d’épreuves insurmontables pour tout autre qu’Ulysse, avec un retour dans sa propre demeure comme un voyage alchimique où il accomplira le Grand Œuvre, c’est-à-dire se découvrir Soi-même.
En effet, l’Ulysse de la guerre de Troie ne se sent pas particulièrement investi d’une mission guerrière, ce qui à l’époque est dommageable pour lui. On aurait pu le prendre pour un couard…
Au contraire, à son retour, Ulysse sait qui il est et ce dont il est capable. Il ne laisse aucune chance aux prétendants. Il est le maître chez lui, ce que l’on peut comprendre comme étant maître de lui-même. Le Grand Œuvre est achevé, dans un sens moral, presque spirituel, il a transformé le plomb vulgaire en or. La beauté de la pureté de l’or avec des valeurs comme le courage, de la vaillance, la force, la sagesse.
Plusieurs auteurs bien postérieures à Homère ont imaginé d’autres fins plus sordides les unes que les autres[1]. À titre personnel, je ne les partage pas toutes, car elles ôtent toute valeur initiatique à ce mythe dont nous avons pu constater toute la richesse.
Après dix années à guerroyer, après dix ans d’errance, après avoir été Personne, Ulysse rentre chez lui et est reconnu par sept individus différents dans sept dimensions différentes.
L’identité, source de bonheur
Par le terme « Identité » faut-il comprendre qui l’on est. Celui, que l’on croit être ? Celui que les autres voient en nous ? Les deux ? Le but ultime de la Connaissance, le bonheur ultime, n’est-il pas depuis toujours de se connaître soi-même et d’être enfin soi en harmonie avec toute ce qui entoure ?
Ce dernier épisode répond peut-être à toutes ces questions.
Il est reconnu comme père par Télémaque. On retrouve des valeurs qui confinent au bonheur : la transmission, l’amour, la pérennité, non par l’immortalité, mais par la continuation. Savoir que ce que l’on a construit durera après soi est également une source de bonheur.
Du reste cette continuation trouve son aboutissement aussi dans l’amour, car après la mort d’Ulysse, Télémaque partira sur les traces de son père et épousera Circé qu’Ulysse avait délaissée. À chacun son bonheur…
Il est reconnu par Argos, son fidèle et merveilleux chien de chasse. Il n’a pas besoin de prononcer le moindre mot, l’amour du chien pour son maître est inconditionnel. Les mots ne servent à rien. Ulysse essuie une larme, il sait que son chien sait. Une larme de tristesse. Une larme de bonheur.
Il est reconnu comme le maître de ses serviteurs Eumée et Philetios et, grâce à leur aide, il terrasse tous les prétendants à la main de Pénélope et, par-là même, au trône d’Ithaque. Être maître sur ses terres, œuvrer à sa guise, sans rien ne devoir demander à personne constitue déjà un bonheur en soi.
Il est reconnu par Euryclée, sa nourrice. À défaut de celle qui lui a donné le jour, Anticlée, la nourrice lui confère par sa reconnaissance une renaissance. C’est après cette rencontre qu’il peut reconquérir son royaume et redevenir maître chez lui.
Il est reconnu par Pénélope, son épouse. Retrouver son alter ego, partager ses émotions avec sa femme, évoquer le passé, le présent et le futur avec les mêmes codes sociaux et familiaux procure de la joie, de la sérénité et pourquoi ne pas le redire du bonheur.
Enfin, il est reconnu par Laërte, son père. À travers la métaphore des fruits qu’il lui a donnés, c’est toute son éducation qu’il repasse avec lui. Ce qu’il est devenu grâce à lui. La boucle de la filiation et de la paternité se termine avec cette septième et ultime reconnaissance. L’alpha et l’oméga se rejoignent. Le bonheur est circonscrit.
Ulysse pouvait être heureux partout, mais ne pouvait trouver le bonheur que chez lui.
[1] À titre d’exemple, pour Plutarque Ulysse ne sort pas totalement vainqueur de sa lutte contre les prétendants. Ces derniers reçoivent du renfort et Ulysse doit s’exiler pendant encore dix longues années. Pour Pausanias, Ulysse épousa alors une princesse étolienne et en eut un fils. Pour Servius, Pénélope ne fut pas fidèle à Ulysse et se donna même à tous les prétendants. Le fruit de ces amours serait Pan ce dieu lubrique à corne et à pieds de bouc.
*
Article précédent : Odyssée, étape 12
Mythologos de Franck Senninger
Milon de Crotone a gagné les Jeux olympiques de lutte dans la catégorie des plus jeunes quand un « inconnu » du nom de Pythagore lui annonce qu’il ne remportera plus jamais de victoires à moins qu’il ne suive ses conseils.
Commence alors, une véritable initiation au travers des plus grands mythes grecs, dont le sens caché lui est peu à peu révélé. Il deviendra alors le plus grand athlète de tous les temps au palmarès inégalé.
Mais le bonheur a un prix…
Ce livre peut aussi vous intéresser : Je m'appelle Aspasie